Graoulliennes, Graoulliens, amical bonjour de la pointe Bretagne ! Le 22 octobre, aujourd’hui, je ne m’en fous pas : comme le rappelle notre ami Jonathan, Georges Brassens aurait eu 90 ans aujourd’hui s’il n’avait pas eu la mauvaise idée, bras dessus, bras dessous, de partir je ne sais où faire ses noces avec la camarde.
Cela dit, pour une fois, j’aimerais corriger quelque peu mon voisin de colonne qui conclut son article ainsi : « Mais la meilleure façon de rendre hommage à Brassens, c’est bien sûr d’écouter, de jouer ses chansons, et d’en écrire de neuves avec la même exigence pour le verbe que pour la note, mais surtout de faire vivre les valeurs qu’il chérissait par-dessus tout: la liberté, l’amitié et l’intégrité. » Cela n’est pas faux, évidemment, mais il oublie dans son énumération un autre moyen de rendre hommage au poète sétois : le lire.
Les poèmes de Georges Brassens, tels qu’ils ont été recueillis dans Les couleurs vagues et autres recueils, c’est Georges avant Brassens, c’est-à-dire avant que le poète introverti n’ose, poussé par ses proches, monter sur scène chanter ses chansons. Le grand public fit alors connaissance avec un Brassens dont le style était abouti, mais jamais le génie, pas plus que la plus belle des fleurs, n’émerge du jour au lendemain. Ainsi, ces poèmes, qui ne connurent, à l’époque de leur publication, qu’une diffusion assez confidentielle, manifestent l’émergence d’une pratique, d’une atmosphère, même, qui allait donner à Brassens son caractère unique dans le paysage de la chanson.
Le recueil Les couleurs vagues, composé d’œuvres de jeunesse antérieures à 1939, laisse encore transpirer l’influence exercée par Baudelaire, Verlaine et compagnie ; les thèmes évoqués et leur traitement vous feront sûrement penser aux œuvres poétiques de lycéens de première L, à l’image de ce quatrain d’une facture quelque peu naïve :
« Prions, mon amie, avec eux,
Pour que Dieu veuille
Que notre amour dure plus que
La pauvre feuille. »
Sauf le respect que l’on doit au grand Georges, force est de reconnaître que les écrits de l’adolescent qu’il était ne brillaient pas par leur sauvage originalité : l’amour, la fuite du temps, l’automne… Le poème « clochers d’automnes » a d’ailleurs clairement été inspiré par Verlaine, le fait de faire rimer « automne » avec « monotone » faisant irrésistiblement penser à ce dernier.
À la décharge du jeune Georges, il est vrai que les poèmes qui viennent d’être évoqués n’étaient pas destinés à la publication, contrairement à ceux qui composent le recueil Des coups d’épée dans l’eau, daté de 1942 et dont certaines pièces manifestent déjà le sens de la dérision et l’esprit contestataire qui ont valu au chanteur sa mauvaise réputation : « Neige » par exemple, utilise un ton proche d’une épopée guerrière pour raconter…une bataille de boules de neige ! Parodique, mais aussi pacifiste (compte tenu de l’année à laquelle le recueil a été composé, ce n’est évidemment pas innocent) quand le poète, faisant s’achever la bataille par l’intervention d’une concierge armée d’un balai, clame :
« Ah ! Si toutes pouvaient se terminer ainsi,
Hélas, trois fois hélas ! Au revoir et…merci. »
Signalons aussi « Passe-temps », poème antiraciste et probablement aussi anticolonialiste, donc extrêmement audacieux, sur le fond, pour l’époque, et une « conclusion » qui explicite la colère ayant conduit Brassens à écrire, laquelle allait trouver à s’exprimer dans ses chansons sur un ton beaucoup plus feutré :
« Le siècle où nous visons est un siècle pourri.
Tout n’est que lâcheté, bassesse.
Les plus grands assassins vont aux plus grandes messes
Et sont des plus grands les plus grands favoris.
Hommage de l’auteur à ceux qui l’ont compris.
Et merde aux autres ! »
Mais c’est dans À la venvole, daté lui aussi de 1942 et édité, à l’époque, à compte d’auteur, que la maturité de l’auteur Brassens commence à s’épanouir et à permettre l’écriture de véritables joyaux. La conclusion d’ « Illusions » par exemple, sonne comme un ajout prématuré au manifeste de Stéphane Hessel :
« Grâce aux illusions, les jeunes tenteront
Des entreprises
Qui échoueront.
Mais les leçons seront comprises.
Et leurs cadets réussiront. »
Ça y est, je sais enfin quoi répondre chaque fois qu’on me dira « ‘faut pas s’faire d’illusions » ! Ensuite, quand on lit « Les héros », qui rend aux individus vivant comme ils peuvent cette aventure impitoyable que le quotidien peut devenir, on se demande pourquoi Brassens, quelques années plus tard a mis en musique « La prière » de Francis Jammes alors qu’il avait déjà ce poème de son cru qui disait la même chose avec des grâces qui n’avaient rien à envier à l’œuvre de son prédécesseur. Ah, les artistes, j’vous jure !
Bref, si les poèmes de Brassens font partie, à mon humble avis évidemment, du bagage que doit posséder tout admirateur du chanteur, c’est tout simplement parce qu’ils font mieux que montrer une face (à peine) cachée du personnage : ils nous font assister à la naissance d’un art du verbe. La filiation entre toutes ces œuvres de jeunesse et les chansons qui ont rendu Brassens célèbre est évidente dans « Les enfants qui chapardent des crânes terreux », poème « retrouvé » de 1942 où l’on retrouve le vers « en effeuillant le chrysanthème », trouvaille dont Georges le grand était suffisamment fier, à juste titre, pour la reprendre dans une de ses plus belles chansons, « Le testament ». Naissance d’un art, mais aussi d’un anar, comme en témoignent les deux quatrains qui suivent et où l’on remarque sans peine la verve dont Brassens a toujours su faire preuve pour combattre les ennemis de la liberté, qu’ils portent un béret rouge ou une soutane :
« Haïssons le chant militaire
Qui joue au souvenir des morts ;
Car son rythme guerrier fait taire,
Dans le meilleur cœur, le remords. »
« Le clergé vit au détriment
Du peuple qu’il vole et qu’il gruge ;
Et que, finalement,
Il juge. »
Quand je pense à Brassens, je bande, mais quand je pense à Bénabar, là, je ne bande plus : la bandaison, Télérama, ça ne se commande pas ! En clair, quand je lis ces vers sur lesquels souffle un vent de liberté indomptable et de lucidité invincible, je n’en déplore que davantage la frilosité ambiante ; les chaussettes molles de la « nouvelle scène » qui ne savent parler que de la vie quotidienne ne font vraiment pas le poids… Et encore, vous, les Lorrains, vous n’êtes pas trop mal lotis ! Vous, au moins, vous avez Éric Mie… Allez, kenavo !
Georges Brassens, Les couleurs vagues et autres recueils, 90 pages, éd. Librio, 3€.
P.S. : Quand le Graoully, le 15 juillet dernier, s’était mis à l’heure des années 80, je vous avais troussé un « poulet de presse » spécial dans lequel j’avais consacré un paragraphe à la mort du grand Georges. Tiens, voilà d’ailleurs une bonne raison pour ne pas être nostalgique des années 80 : une époque où il a fallu apprendre à se passer de Brassens ne peut pas être une bonne époque… Quoi qu’il en soit, en guise de « bonus », voici donc, pour parfaire mon hommage au chanteur, le paragraphe chroniquant le Paris match qui consacrait sa une à la mort de l’artiste :
 Paris match n°1694 (13/11/1981) : Pour une fois, il y a quelqu’un de bien à la une de Paris match ! Manque de pot, c’est parce qu’il est mort… En quelques photos, l’hebdomadaire relate la vie de Brassens, vie que l’on connait mal, tant le chanteur avait su la protéger jusqu’au bout : c’est à son enterrement que l’on a enfin su qui était sa compagne, laquelle n’a effectivement pas eu besoin d’oignons pour verser des larmes. De toute façon, sa vie, de même que celle de Corne d’auroch, n’avait pas été originale : quelques peccadilles dans sa jeunesse, le STO puis la fuite sans entrée dans la résistance, un peu de militantisme pour des valeurs auxquelles il est resté fidèle sans jamais pour autant appeler au combat (« mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente ») et enfin le succès, obtenu sans le vouloir, puis les amis, les chats, etc. Rien de très original, ce qui n’est pas si étonnant : le poète n’avait pas cherché à vivre publiquement par un autre biais que celui de ses chansons – il a d’ailleurs été en grande partie poussé par ses proches pour les chanter en public ! – et n’a donc jamais joué le jeu du show-business sans pour autant cultiver la marginalité outrancière, ce qui est à son honneur, pas plus qu’il n’a pris part, individualiste forcené (« le pluriel ne vaut rien à l’homme »), aux événements politiques. En fin de compte, pour vraiment connaître Brassens, il faut avoir compté parmi ses amis, chance qu’a eue Jean-Pierre Chabrol dont l’article de trois pages et demi (bizarrement paginé, au demeurant, par Paris Match puisqu’il faut sauter quarante pages du magazine pour en lire la fin !) nous en apprend infiniment plus sur le chanteur que tout le reste du dossier…
Paris match n°1694 (13/11/1981) : Pour une fois, il y a quelqu’un de bien à la une de Paris match ! Manque de pot, c’est parce qu’il est mort… En quelques photos, l’hebdomadaire relate la vie de Brassens, vie que l’on connait mal, tant le chanteur avait su la protéger jusqu’au bout : c’est à son enterrement que l’on a enfin su qui était sa compagne, laquelle n’a effectivement pas eu besoin d’oignons pour verser des larmes. De toute façon, sa vie, de même que celle de Corne d’auroch, n’avait pas été originale : quelques peccadilles dans sa jeunesse, le STO puis la fuite sans entrée dans la résistance, un peu de militantisme pour des valeurs auxquelles il est resté fidèle sans jamais pour autant appeler au combat (« mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente ») et enfin le succès, obtenu sans le vouloir, puis les amis, les chats, etc. Rien de très original, ce qui n’est pas si étonnant : le poète n’avait pas cherché à vivre publiquement par un autre biais que celui de ses chansons – il a d’ailleurs été en grande partie poussé par ses proches pour les chanter en public ! – et n’a donc jamais joué le jeu du show-business sans pour autant cultiver la marginalité outrancière, ce qui est à son honneur, pas plus qu’il n’a pris part, individualiste forcené (« le pluriel ne vaut rien à l’homme »), aux événements politiques. En fin de compte, pour vraiment connaître Brassens, il faut avoir compté parmi ses amis, chance qu’a eue Jean-Pierre Chabrol dont l’article de trois pages et demi (bizarrement paginé, au demeurant, par Paris Match puisqu’il faut sauter quarante pages du magazine pour en lire la fin !) nous en apprend infiniment plus sur le chanteur que tout le reste du dossier…

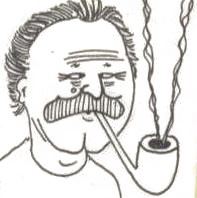

 Courriel
Courriel