Mercredi 13 mai
9h : J’ai beaucoup moins bien dormi qu’hier : ce que m’a dit l’ancien doyen de la fac m’a tourmenté. Je me lève, souffrant autant du physique que du moral : physiquement, j’ai encore dans mes mollets les deux longues marches d’hier et d’avant-hier ; moralement, comment ne pas être au fond du trou alors que tout le monde ne parle que de « deuxième vague » ? Je désespère de me réveiller de ce cauchemar !
Jeudi 14 mai
9h20 : Hier soir, j’ai eu des nouvelles de deux amies : l’une, qui travaille dans une école, n’est plus motivée par son travail parce qu’elle a « l’impression d’être à l’armée » et ajoute qu’elle trouve tout cela « temporairement long » ; l’autre, mère de deux enfants, est déprimée de ne pas pouvoir faire de câlins et de devoir tenir ses petits chéris à l’écart de leurs grands-parents… C’est vrai que ce n’est pas une vie ! C’est pour notre santé , dites-vous ? Mais à quoi ça peut bien servir, d’être en bonne santé, si c’est pour vivre sous vide, sans pouvoir s’aimer ? Eviter de mourir, ce n’est pas la même chose que vivre : c’est même souvent le contraire… Autant s’enfermer dans un cercueil tout de suite ! Je préfère risquer d’être malade que ne plus jamais serrer dans mes bras les gens que j’aime !
13h30 : Passage chez la coiffeuse : j’en ai marre de devoir porter un serre-tête pour y voir clair. En attendant cette libération, je dois subir une autre épreuve : porter un masque pour la première fois… Autant le dire tout de suite : c’est insupportable ! Comment peut-on respirer sous un truc pareil ? On n’est peut-être pas contaminé par le coronavirus, mais on risque de mourir étouffé ! C’est plus rapide, quoi !
Vendredi 15 mai
9h30 : Pour la première fois depuis deux mois, je me rends au marché. Seule vraie contrainte : il y a une entrée et une sortie. Les commerçants ne sont même pas tous masqués. Un vieux type essaie de sortir par l’entrée, se fait rappeler à l’ordre et proteste que le sens imposé l’oblige à faire un détour pour rejoindre sa voiture. Comme le détour l’oblige à emprunter la belle côte que je dois moi-même monter chaque fois que je sors de chez moi, je comprends un peu son agacement : quand on fera le bilan de l’épidémie, est-ce qu’on comptabilisera les morts dues à l’effort physique trop important imposé aux petits vieux souffreteux ?
15h30 : N’ayant rien d’autre à faire, je sors poster quelques paquets ; le bureau de poste de mon quartier est encore fermé, la réouverture est annoncée pour le 3 juin. Comme il n’est pas tard, je m’offre une nouvelle marche jusqu’au centre-ville. Chemin faisant, je remarque un bus dont un passager, un homme visiblement âgé, ne porte pas de masque… Je ne lui jetterai pas la pierre, le bus est presque vide, mais ça me conforte dans la conviction, déjà bien étayée par l’altercation de ce matin au marché, suivant laquelle il devient difficile, quand on prend de l’âge, à s’adapter à des changements de règles…
Samedi 16 mai
9h : J’ai récemment découvert la série animée Mafalda qui avait été réalisée en 1993 : j’apprécie le fait qu’elle soit muette, j’aurais trouvé dommage qu’une voix autre que celle des lecteurs du monde entier devienne celle de l’héroïne de Quino. Déjà que je ne peux plus lire Astérix sans entendre la voir de Roger Carel, ni Lucky Luke sans entendre celle d’Antoine De Caunes, ni Iznogoud sans entendre celle de Gérard Hernandez… Non, la voix de Mafalda doit rester celle des faibles et des opprimés du monde entier.
17h : Je rentre de chez mes parents où j’étais allé déjeuner. J’avoue que ça m’a fait un bien fou, d’autant que revoir mon père après deux mois de séparation n’était pas un luxe ! De toute façon, quand je vois les insectes qui butinent, les oiseaux qui chantent, les rues pleines de fleurs, les arbres pétants de santé, comment croire que nous sommes en situation de catastrophe ?

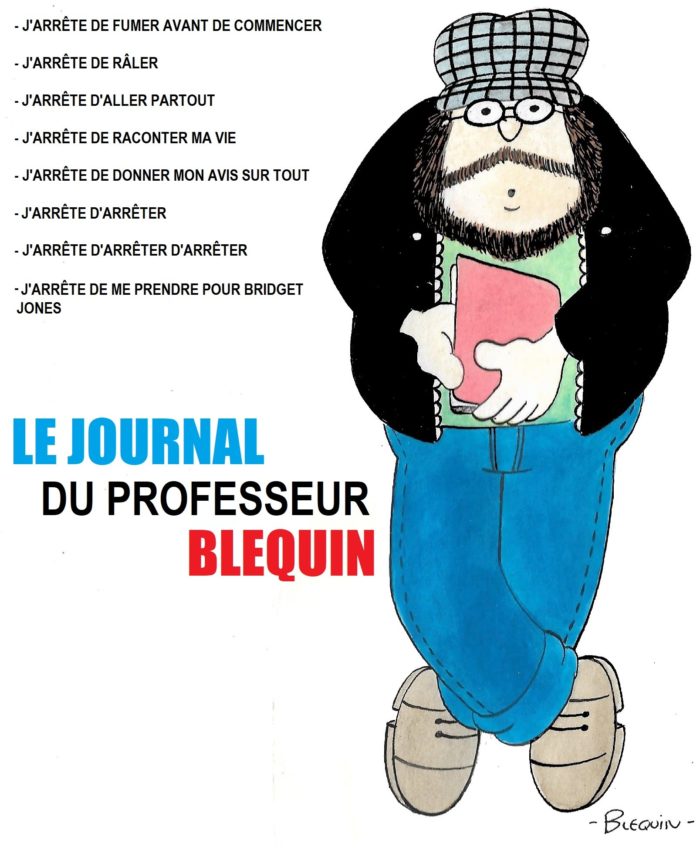
 Courriel
Courriel